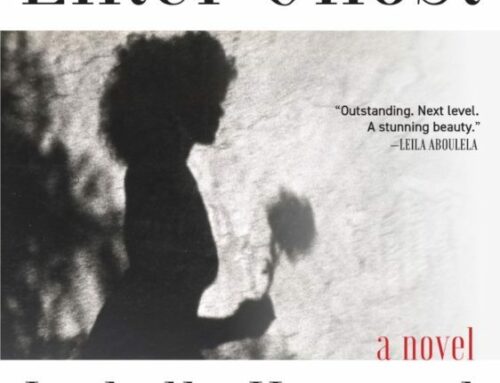Privés d’État de la façon la plus traumatisante, les Palestiniens ont maintenu vivant leur droit au retour en construisant une dynamique et en faisant prospérer la culture nationale. À travers la littérature, l’art, la musique, la mode et le théâtre, le rêve palestinien est bien vivant.
Nakba, le mot arabe pour « catastrophe », renvoie à la dépossession et au déplacement de près de 750 000 Palestiniens en 1948, suivant la création d’Israël.
Même si « catastrophe » suggère un événement particulier du passé, la Nakba, pour les Palestiniens, est une abréviation désignant une série de désastres qui les ont frappés, à commencer par le Premier Congrès Sioniste de 1897, le pic de 1948 et ce qui continue aujourd’hui en un système évolutif d’occupation militaire et d’apartheid.
On pourrait même dire que c’est un événement du passé qui se produit dans le présent, agissant à la fois comme souvenir collectif traumatique et comme signifiant de la lutte actuelle pour l’autodétermination.
Les intellectuels ont souvent analysé la Nakba à partir de ses répercussions statistiques et politiques, se centrant principalement sur la destruction de propriétés, de villages et de centres urbains, ainsi que sur la transformation de la plupart des Palestiniens en réfugiés.
Cependant, derrière les statistiques se développe la réalité la plus troublante de la Nakba en tant qu’interruption violente de la vie palestinienne et du quasi-effacement du tissu social et culturel palestinien, qu’aucune autre société n’a expérimenté dans l’histoire moderne.
![Enfants palestiniens en costume traditionnel pour le 74ème anniversaire de la Nakba [Getty Images] Enfants palestiniens en costume traditionnel pour le 74ème anniversaire de la Nakba [Getty Images]](https://yasmine.jeantrebuchet.net/wp-content/uploads/2022/06/image_1-edf.jpg)
Enfants palestiniens en costume traditionnel pour le 74ème anniversaire de la Nakba [Getty Images]
Privés d’État, désorientés et dépourvus de moyens matériels et politiques suffisants, les Palestiniens de l’ère post-Nakba ont vu dans leurs symboles culturels, leurs emblèmes et leurs objets artisanaux, des lieux alternatifs de pouvoir pour garder vivantes l’histoire et l’identité palestiniennes.
Comme le met en avant Edward Saïd dans La Question de la Palestine (1992), après la perte de la Palestine, elle a continué à exister comme idée, comme expérience politique et humaine, et son existence s’est appuyée sur des actes émanant d’une volonté populaire durable.
Par des représentations culturelles, cette volonté a été soutenue et mise en contexte et, avec elles, les Palestiniens ont transformé leurs camps de réfugiés et leur existence diasporique en une Palestine parallèle.
Les objets culturels comprennent, sans se limiter à la musique et à la danse folklorique (Dabkeh), des anecdotes, de la poésie orale, de la broderie, de la cuisine et, à des étapes ultérieures, de la littérature et des arts visuels.
Les Palestiniens ont même préservé leurs modes d’interaction sociale et les structures d’avant la Nakba. Les vieux stéréotypes internes au village et au clan, la concurrence, la rancune, de même que des coutumes spécifiques aux villages semblent avoir survécu à l’épreuve du temps.
Les différences entre des sous-cultures, les divisions sociales, les classes qui définissaient la Palestine d’avant 1948 sont aussi encore visibles aujourd’hui, en quelque sorte.
Notez bien que même si une forme moderne de gouvernance existe, le modèle traditionnel de direction clanique connue sous le nom de Moukhtar (le chef âgé des familles d’un même village ou d‘une même ville de la Palestine historique), demeure communément pratiqué dans des conflits inter familiaux et dans les affaires civiles comme le mariage.
Mais assurer un continuum culturel ne s’est jamais fait sans défis, en partie du fait de l’absence initiale d’une compétence palestinienne officielle d’archivisme, mais surtout à cause de l’appropriation et de l’effacement de l’histoire palestinienne par Israël.
Les objets culturels ont été et sont régulièrement décontextualisés et présentés comme « israéliens ».
Parmi eux on compte les plats arabes palestiniens traditionnels (par exemple le houmous, le taboulé, le msakhan, les kebbés) et, ce qui est plus célèbre, les vêtements brodés qui sont une forme complexe d’art villageois palestinien et une source de fierté nationale.
Le dernier coup en date, et le plus ironique, a été l’appropriation du keffieh (foulard de tête traditionnel), le symbole même de l’anticolonialisme palestinien.
Ce qui ne pouvait pas être approprié a été l’objet d’un effacement systématique, depuis le vol de manuscrits et la dissimulation de matériaux d’archives jusqu’au pillage et à la destruction de traces archéologiques de l’histoire palestinienne.
L’universitaire israélien Ilan Pappé définit très justement le phénomène par le terme de « mémoiricide » qui, selon l’explication de l’universitaire palestinien Nour Masalah, est un processus de « désarabisation de la Palestine et d’effacement de son histoire et de sa mémoire collective… un génocide culturel qui n’est pas moins violent que le nettoyage ethnique physique du peuple palestinien ».
Sans cette élimination, l’historiographie israélienne actuelle aurait été différente et les prétentions sionistes « d’indigénéité » impensables.
C’est pourquoi, dans la culture populaire palestinienne, la prise de contrôle sioniste de la Palestine est assimilable à « la jouissance d’une maison entièrement équipée ».
La Palestine était un pays bien établi des points de vue politique, architectural, et administratif et tout ce que firent les nouveaux immigrants juifs européens fut de renommer « le mobilier » comme si c’étaient le leur.
Il fallut aux Palestiniens plus d’une décennie après la Nakba pour réaliser la gravité de leur perte. Au point que ce fut la première génération post-Nakba plus éduquée arrivant à la majorité qui a lancé une « littérature révolutionnaire » comme mode de représentation culturelle renouvelé et plus clair.
La force centrale de la littérature – romans, poésie, et nouvelles – réside dans sa capacité à modeler la mémoire palestinienne, par l’histoire et par l’expérience vécue, dans une forme qui peut être vue et identifiée par le public. Elle a, en d’autres termes, aidé à préserver la culture palestinienne en faisant entrer l’expérience palestinienne dans la mémoire collective du monde.
![Des Palestiniens portant des drapeaux nationaux se rassemblent sur une plage en commémoration de la Nakba à Gaza City. [Getty Images] Des Palestiniens portant des drapeaux nationaux se rassemblent sur une plage en commémoration de la Nakba à Gaza City. [Getty Images]](https://yasmine.jeantrebuchet.net/wp-content/uploads/2022/06/image_2-aa5.jpg)
Des Palestiniens portant des drapeaux nationaux se rassemblent sur une plage en commémoration de la Nakba à Gaza City. [Getty Images]
Une des oeuvres les plus célèbres de la période est Retour à Haïfa de Ghassan Kanafani (1969). Elle décrit le voyage d’un couple palestinien qui retourne dans sa ville natale après la guerre de 1967, à la recherche de leur enfant, Khaldoun, qu’ils ont perdu lors de la Nakba.
Ils découvrent que leur ancienne maison est désormais occupée par une famille juive européenne et que leur fils perdu, trouvé et élevé par cette famille, est maintenant juif et enrôlé dans les forces de défense israéliennes.
Kanafani crée une fiction et personnalise un récit historique qui caractérise l’exode de la Nakba et le sentiment de désorientation de masse qui s’en est suivi. Il illustre de façon tragi-comique comment, à l’instar de maints réfugiés palestiniens, le couple a été privé de sa maison, seuls les souvenirs apportant la preuve de son existence.
Ils ne peuvent pas retrouver leur fils – qui symbolise la terre – mais tout ce qu’ils peuvent faire est de continuer à parler de lui pour créer un sentiment de continuité comme s’il ne s’était rien passé et parce que ne plus se souvenir, c’est le message, s’apparente à un oubli national.
La nouvelle a été publiée à un moment de transition dans l’histoire de la Palestine lorsque la mémoire a commencé à se transformer de narrations victimaires à celles de résistance.
Dans son œuvre antérieure, Des Hommes dans le Soleil (1962), Kanafani a jeté les bases de cette transition, mais Retour à Haïfa témoigne d’une maturité littéraire et a ainsi introduit un diagnostic plus réaliste de la condition palestinienne. Il y accepte la réalité de la condition de victimes tout en la déclarant insuffisante s’agissant de contrecarrer l’effacement de l’existence palestinienne par Israël.
Au cours des deux dernières décennies, la conservation de la culture palestinienne a commencé à transcender les récits historiques et les inquiétudes existentielles en allant vers une nature plus profondément universelle et humaine, au-delà de la rhétorique purement politique, pour souligner le côté hors normes des luttes quotidiennes des Palestiniens.
Cette tendance s’est faite particulièrement visible dans les œuvres littéraires de Palestinien.nes tel.les que Susan Abuhawa, Mourid Barghouthi et Ghada Karmi, parmi de nombreux autres.
On la perçoit aussi dans la production cinématographique du réalisateur palestinien Hani Abu-Assad, particulièrement dans ses films Omar (2013) et Rana’s Wedding – Le Mariage de Rana (2003).
Envers et contre tout, les Palestiniens ont réussi à préserver leur héritage culturel après l’effondrement sociétal qui a suivi la Nakba et, de cette manière, ils ont petit à petit recousu leur identité nationale dispersée.
Pour autant, bien que 74 années soient passées, la Nakba continue à être la source inépuisable d’où la culture palestinienne tire sa signification et trace une trajectoire pour l’avenir.